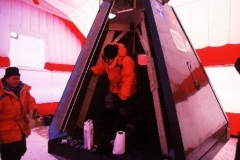ACADEMIE DU LANGUEDOC
Séance solennelle d’automne 2023
Salle des illustres du capitole de Toulouse
mardi 12 décembres 2023
Éloge du général de corps d’armée Jean-Paul Raffenne
Pour sa nomination Président d’honneur
de l’Académie du Languedoc
Par le Dr Jean-François Gourdou, secrétaire perpétuel
——————–
Monsieur le maire de Toulouse Francis Grass
Encore tous nos remerciements pour votre accueil dans cette magnifique salle,
Chères consœurs, chers confrères, chers lauréats,
Mesdames, messieurs, chers amis de l’Académie du Languedoc
Monsieur le général Jean Paul Raffenne, cher ami.
L’Académie du Languedoc a le plaisir et l’honneur de vous nommer président d’honneur de notre Académie, au vu de vos grandes qualités, continuant une longue tradition de parrainage de l’Académie par des personnalités amies du Languedoc.
D’une part pour votre carrière militaire exceptionnelle de General de corps d’armée quatre étoiles, que nous allons présenter.
Et d’autre part pour votre installation en Languedoc, qualité nécessaire pour l’Académie, justement du Languedoc, cela en plusieurs étapes jusqu’à votre domicile actuel au centre de Toulouse.
Toutefois vous êtes originaire de la langue d’oïl du nord, d’un petit village Le Puix au pied du Ballon d’Alsace, sur l’ancienne frontière franco-allemande de 1871 à 1919. Vous vous plaisez à dire que vous été né un 11novembre 1944, qui fut une date décisive de la bataille des Ardennes à la fin de la 2éme guerre mondiale, ce qui a pu influencer votre vocation militaire, le colonel Denfert -Rochereau ayant sauvé la ville de Belfort proche de votre village.
Apres de brillantes études à Belfort, vous intégrez à Paris la célèbre Ecole du Prytanée militaire la Flèche, pour préparer l’école Spéciale militaire de Saint Cyr- Coëtquidan, ou vous êtes admis en bonne place. Apres cette dure école d’officier parachutiste, avec toutefois de belles parades en grand uniforme et bicorne, sous la direction du général de Boissieu, vous sortez dans un bon rang ce qui vous permit de choisir votre affectation. Vous optez alors pour le corps d’élite des Troupes de Marine, équivalent des Marines Américains.
Aout 1968, votre première affectation sera Castres, ainsi premier signe du destin, vous choisissez déjà le Languedoc, pour le 8 ème RPI, Régiment Parachutiste d’infanterie de Castres, célèbre régiment illustré à Dien Bien Phu en Indochine et ensuite en Algérie, régiment devenu professionnel en 1970.
Mai 1970 Nomination Lieutenant. première grande mission le Tchad à la tête d’un commando de 40 parachutistes volontaires vous rejoigniez Fort Lamy pour soutenir le 3 eme régiment inter armes d’outre-mer pour contenir la rébellion d’ Hissane Habré, aidé par le colonel Khadafi. Ce fut un succès mais avec de durs combats avec des embuscades dans le désert brulant .Ce fut pour vous une expérience exceptionnelle de responsabilité militaire et humaine qui fera de vous un officier apprécié et respecté par toute la hiérarchie militaire.
Vous allez ensuite avoir de nombreuses autres affectations à responsabilités de combattant
1972 Pau instructeur Moniteur à l’Ecole des Troupes Aéroportées du parachutisme en chute libre
1973 Nomination, Capitaine
1975 Comores Compagnie de combat pour couvrir l’indépendance des iles
1976 en mai Saint Pierre de la Réunion. Adjoint au chef de corps du 21 eme Régiment d’Infanterie de Marine.
1978 Nomination Commandant Toulouse Palais Niel deuxième signe du destin.
Puis Sud Liban, officier de renseignement dans la Finul des casques bleu,
1983 et 1985 Paris cours à l’école supérieure de guerre, Breveté de l’école supérieure de guerre.
1986 Djibouti Commandant en second du 5 ème régiment inter armes d’outre-mer
1987 Paris Professeur à l’école supérieure de Guerre inter armées, Paris
I987 Nomination Colonel
1988 Retour à Saint Pierre de la Réunion, commandant le 21 ème régiment Parachutiste d’infanterie de marine. Mission Comores. Vous avez réalisé depuis la Réunion un exploit extraordinaire avec un Raid parachuté unique pour extraire les mercenaires de Bob Denard qui avaient pris le pouvoir après l’assassinat du président.
1990 vous allez alors changer complètement en devenant administrateur
Paris Convocation au ministère des Armées
En effet le ministère des Armées avait constaté que après vos exploits de combattants vous n’aviez pas eu encore de poste dans l’Administration centrale des armées aussi on vous proposa un poste à Paris au ministère.
USA Fort Leavenworth Kansas Refus de votre part, aussi proposition d’un poste D’ Officier instructeur de liaison aux Etats unis au Centre d’intégration interarmes du grand complexe militaire américain. Lors de la guerre du Koweït collaboration avec les américains pour la tenue des soldats Etudes de l’Us Army. Visite de général Cot Aux Usa félicitations
1994 Nomination General de Brigade 2 étoiles. Nomination à Paris puis Ambassadeur de France attaché militaire à Washington.
1996 Guerre des Balkans, corps de réaction rapide de l’OTAN, Patron du bureau plan politique de la force de stabilisation en Bosnie Herzégovine
1997 Directeur des relations internationales de l’état-major des Armées puis sous-chef d’état-major
1998 Nomination General de Division 3 étoiles. Directeur sous-chef d’état-major des armées en charge des relations internationales.
2000 Bruxelles Proposition d’une défense européenne avec le Président Français Jacques Chirac, et le 1 er ministre anglais Tony Blair
2000 Nomination Général de corps d’armée 4 étoiles.
Tampa Floride pour l’Afghanistan, opération Héraclès, liaison avec le Commandant Américain
2002 ROME élu pour 3 ans Commandement du collège de Défense de l’OTAN à Rome
2005 -2009 Allemagne Garmisch Centre américain d’études et de sécurité Georges Marshall
- Disponibilité, 3 ème retour à Toulouse
Aussi vous avez eu toutes les décorations françaises et encore celles du Tchad, des USAet de l’OTAN. Commandeur de la Légion d’Honneur, grand officier de L’ordre du Mérite, officier de la légion of Mérit américaine….
Mais toujours très actif vous devenez professeur à l’université Capitole à l ‘Institut d’études politiques de Toulouse.
Et membre de plusieurs associations : Ambassadeur du vin de Fronton, compagnon de la table ovale du rugby à 13, membre de l’Académie Toulousaine des Arts et Civilisations d’Orient et ce soir président d’honneur de l’Académie du Languedoc.
Quelle fabuleuse carrière, vous êtes vraiment un homme d’exception, un grand militaire, un temps baroudeur puis un grand chef d’état-major international, Franco -Anglo – Américain, un homme d’action, de réflexion, d’ouverture et d’humanité.
Applaudissons notre nouveau Président d’Honneur de L’Académie du Languedoc
Recevez votre diplôme d’appartenance, Félicitations.
Docteur jean- francois Gourdou, secrétaire perpétuel